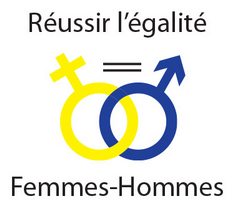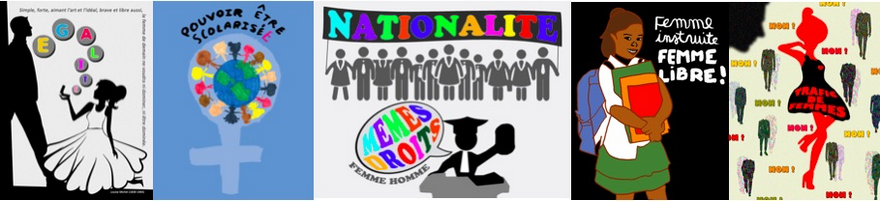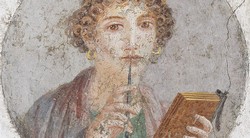Lors de l'atelier L’école des filles organisé par REFH au 8e Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF2018, Université Paris Nanterre, 27-31 octobre 2018),
Maria Stéfanou, Docteure en linguistique et didactique du français, a fait une intervention sur "Espace francophone et enjeux féministes : le rôle des établissements français dans l’éducation des filles en contexte hellénophone (XVIIIe-XXe siècles)".
Voir le résumé de cette intervention
L'article que REFH a écrit sur "Les femmes dans l'histoire enseignée au collège. Programmes de 2015 et manuels de 2016."
est paru dans la revue Éducation & formations n°98 - L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif – volume 3
par Catherine Chadefaud, Claire Desaint, Nicole Fouché
Cet article traite de l’égalité filles-garçons/femmes-hommes ainsi que de la présence des femmes dans la discipline scolaire : histoire. Il compare les programmes d’Histoire de 2015 (de la sixième à la troisième) publiés au B.O.E.N. et seize manuels scolaires qui en sont issus. Ce suivi montre que les rédactrices et les rédacteurs sont fidèles aux directives données par le Conseil supérieur des programmes, d’où son rôle décisif. Lorsque les instructions sont formelles, un effort de représentation des femmes est poursuivi. Lorsqu’elles sont inexistantes ou réduites à des vœux, les équipes des manuels ne prennent aucune initiative pour remédier à cette carence des programmes.
Des pans des programmes – de l’Antiquité au début du XXIe siècle – ne tiennent pas compte des résultats de la recherche nationale et internationale qui s’évertue avec succès à dévoiler la présence des femmes dans l’histoire. De plus, depuis les années 1980, quantité de textes officiels, émanant des gouvernements successifs et de leurs ministères, accompagnent l’égalité filles-garçons et les développements de la recherche. Hélas, ils ne sont pas respectés.
L’article s’achève sur plusieurs pistes et propositions afin de remédier, dans le cadre des programmes actuels, à l’invisibilité des femmes. Nos propositions, à ce stade assez générales, pourront s’exemplifier, se singulariser et se concrétiser, au point de fournir aux enseignantes et aux enseignants, ainsi qu’aux élèves des modèles identificatoires, grâce à l’usage qu’elles et ils pourront faire des excellents dictionnaires biographiques et de diverses monographies consacrés aux femmes signalés dans notre bibliographie.
Les femmes dans l'histoire enseignée au collège. Programmes de 2015 et manuels de 2016.
Cet article est paru dans le troisième volume d'un ensemble de quatre numéros consacrés à la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif. Il fait suite aux n° 96 et n° 97 respectivement publiés en mars et en septembre 2018.
Le numéro 99 est paru en juillet 2019.
Voir le CR des 4 numéros par Nicole Fouché
5 décembre : débat sur Éducation et intérêt général, Quelles ambitions pour notre système éducatif ?
CIRIEC France a organisé, avec la MGEN, une soirée débat portant sur « Éducation et intérêt général, Quelles ambitions pour notre système éducatif ? » le mercredi 5 décembre .
Lors de cette manifestation, présentation de l’ouvrage édité par le CIRIEC sur ce thème .
Fidèle à sa méthode, le CIRIEC a élaboré un ouvrage collectif auquel a contribué une quarantaine d’auteurs, universitaires, chercheurs, praticiens de l’éducation. Ils y abordent les grandes
questions de l’organisation et de la performance du système éducatif français. Ils traitent dans cette perspective du niveau atteint par les élèves, de l’exigence d’égalité, du caractère non marchand du système.
Quelle est l’implication des acteurs ?
Quelle est l’aptitude de l’École à former des citoyens à l’exercice de la démocratie et à insérer les élèves dans la vie sociale ?
Cette soirée sera également l’occasion d’évoquer la perception des français et des adhérents MGEN du système éducatif.
Palais des Congrès de Paris
Anticiper l’éducation de demain dans l’action.
Commémorons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme en rappelant que l’éducation est un droit vitalpour le progrès de l’humanité, la sauvegarde de l’Environnement et l’atteinte des Objectifs du Développement Durable.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
www.ge7conference.org
Voici la réaction de l'association Mnémosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre à la consultation sur les nouveaux programmes d'histoire proposés par le ministère de l'éducation nationale et le CSP présidé par Mme Souad Ayada.
Après une lecture attentive du préambule et des différents thèmes proposés dans les programmes de seconde et de première, l'association Mnémosyne souhaite rappeler certains points.
Extrait :